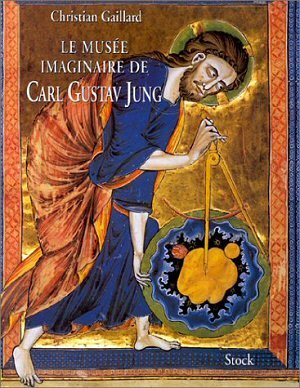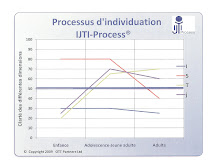La guerre sainte,
l’âme humaine esclave des forces
collectives
La
guerre sainte, deux mots qui d’abord paraissent antinomiques. En effet, comment
une guerre peut-elle être sainte ? Que les hommes aient depuis toujours
été contraints de faire la guerre, la chose paraît assez naturelle, le fond
d’agressivité existant en leur âme demandant à être exprimé, tout au moins
canalisé. Mais qu’il faille la déifier en affirmant la mener au nom d’un
principe tenu pour sacré, c’est en rendre la limitation bien problématique.
Pour
Carl Gustav Jung, l’un des fondateurs de la psychanalyse, c’est une tendance
qui prend toute sa pertinence dans la mesure où elle pose le problème des
rapports entre l’individu et la collectivité dont il est membre. Dans quelle
proportion, précisément, peut-il abdiquer sa liberté personnelle face aux
exigences de la communauté ? Répondre à
cette question revient à s’interroger sur la relation qu’il entretient avec son
âme. Jung estime que le rôle de celle-ci est d’être un pont entre sa conscience
et le monde immense de son inconscient. Or, si ce dernier est, pour partie,
personnel à chacun, une autre partie demeure collective, dans la mesure où elle
est le fruit de toutes les expériences connues par les hommes depuis qu’ils
existent. En l’inconscient collectif demeurent des richesses formidables aptes
à fortifier la personne dans le cas où elle connaît des troubles graves, mais
qui peuvent aussi, lui faire perdre son autonomie si elle tend à les mépriser. C’est
dans les phénomènes dits de « guerre sainte » que ces forces font
ressentir leur puissance et peuvent amener l’individu à perdre son âme. Telle
est la situation dont rend compte la psychologie de Jung.
Monothéisme et guerre sainte.
Favorisant
la mobilisation de toutes les énergies en une direction unique, une religion de
type monothéiste a pu permettre les phénomènes de guerre sainte. Du reste, il
fallut un temps assez long pour que l’Humanité puisse accorder sa foi à un seul
Dieu.
Longtemps
en effet, elle préféra tourner ses préoccupations sur des croyances
reconnaissant l’existence d’une pluralité de puissances, davantage propres à
exprimer toute la diversité de la psychologie humaine. C’est ainsi que le
polythéisme fut longtemps la règle dans toutes les sociétés. Non que les hommes
n’aient eu la prémonition qu’existait un seul Dieu, inconnu, source de toutes
choses. Simplement, il restait confiné dans les sanctuaires et ne concernait
que quelques prêtres initiés. Avec le peuple hébreux, pour la première fois
Dieu était mis à la portée de tous et il appartenait à chaque homme de reporter
sur Lui ses adorations. En même temps, une responsabilité immense pesait
soudainement sur ses épaules.
En
effet, les religions païennes traditionnelles s’appuyaient non sur un dogme
mais sur des rites établis par une tradition remontant du fond des âges. Il ne
s’agissait pas de foi mais de croyances. Issues du fond de notre âme, celles-ci
s’imposaient à la conscience humaine comme des forces puissante exprimées au
moyen de mythes appropriés, autant d’images nous donnant une vision précise de
la nature humaine. Se proposant à notre attention de manière irraisonnée, elles
ne permettaient que dans une certaine mesure à notre libre arbitre de
s’exprimer. Précisément, la liberté humaine n’était alors pas reconnue et l’on
sait l’importance que les Anciens accordaient à la fatalité. L’histoire de
Crésus en témoigne, il est toujours vain de vouloir échapper à son destin.
Cependant, toutes ces traditions gardaient un caractère sécurisant par leur cadre
rigide, lequel imposait des règles précises où se trouvait étroitement circonscrite
l’action humaine.
Bien
différente est la foi. Allant plus loin que les simples croyances religieuses,
elle en appelle à la volonté humaine, sollicite l’intelligence de l’homme, est
source chez lui d’unité. Il en découle de sa part une force d’âme accroissant
le champ de sa conscience et mettant au plus haut niveau le sens de ses
actions. Mais un tel sentiment, ainsi exprimé, peut se révéler à double
tranchant. Si elle n’est pas assumée avec tout le discernement nécessaire, la
foi peut être une force atrophiant notre liberté, s’emparant de notre âme,
justifiant la violence, avec son cortège d’horreurs et d’abominations. « Le plus grand problème
du Moyen Age fut d’apprendre à penser. Ils choisirent la plus abstraite de
toutes les idées, l’idée de Dieu, et lui sacrifièrent tout. Des pays ont sombré
devant elle, des familles ont été démembrées par elle, des armées ont été
massacrées dans le but d’apprendre à penser à Dieu »[1].
On
comprend alors la raison pour laquelle il fallut si longtemps à l’Humanité pour
se tourner avec confiance vers une divinité unique tant était incertaines les
conséquences découlant d’un tel changement.
« Le
fanatisme est le frère toujours présent du doute »[2]
disait Jung. Tous ces excès représentent effectivement une volonté de compenser
une infériorité psychologique ressentie par des collectivités en situation de
crise. Les hommes qui participèrent à la croisade le firent à une époque où la
vie était durement perçue, sans cesse menacée par les inondations, les
épidémies, les guerres. S’imaginant qu’ils pouvaient échapper à leur sort, soutenus
par l’idée de la « Jérusalem céleste », ils avaient le désir de
réaliser rapidement leur idéal ici-bas. Dans le même ordre d’idée, connaissant
une existence précaire au sein des solitudes désertiques de la péninsule
arabique, les guerriers nomades furent unis par Mahomet au nom du tout puissant
Allah et se firent conquérants.
Le
thème du « peuple élu » illustre au mieux cette tendance rendue
possible par le monothéisme. C’est afin de faciliter l’unité des douze tribus
d’Israël que les Hébreux, Moïse à leur tête, décidèrent qu’ils constituaient le
« peuple élu ». Dans leur esprit, cette situation ne résultait pas
d’une décision prise par un être de chair, souverain chef charismatique, mais
de la seule volonté du Tout puissant. Pour en faire partie, soit pour avoir
accès à Sa parole, il fallait simplement témoigner de la plus extrême humilité.
Il n’en demeure pas moins que cette idée a pu, tout au long de l’Histoire, être
sujette à des dérives et justifier la volonté de puissance de certains peuples
considérés par eux-mêmes comme appelés.
De
par sa connaissance des diverses traditions du globe, Jung avait su considérer
avec distance sa culture chrétienne d’origine. « Je voyais saint Augustin
transmettant aux Anglo-Saxons, de la pointe des lances romaines, le credo
chrétien et Charlemagne imposant glorieusement aux païens des conversions
tristement renommées. Puis les hordes pillardes et meurtrières des armées des
croisés et ainsi, comme avec un coup au cœur, la vanité du romantisme
traditionnel des croisades me sauta aux yeux »[3].
En confrontant les civilisations les unes aux autres, le psychologue avait en
effet acquis une conception très personnelle de la vie spirituelle, ce qui, en
des temps plus sévère, l’aurait très certainement conduit au bûcher. Jung en
était arrivé à ces convictions du fait de ses nombreux voyages, lesquels ont
contribué à faire sa renommée, et lui permirent de donner une image de l’être humain
dans toute sa diversité.
Tout
particulièrement, son séjour au Nouveau Mexique chez les Indiens pueblo fut
source chez lui d’une riche réflexion quant à la meilleure attitude à adopter
devant le fait religieux. Le savant estimait en effet que ce qui faisait la
force de ce peuple était sa manière très sérieuse de vivre sa vie spirituelle.
Pour lui, elle devait être considérée comme un secret ne devant pas être trahi,
à l’instar des mystères d’Eleusis, sachant ainsi préserver une identité
culturelle qu’une assimilation trop brutale au monde moderne lui aurait fait
perdre. En effet, un fait religieux resté caché fait toujours la part belle à
l’individu par rapport à la collectivité dont il est membre. Chacun garde
intact sa liberté personnelle et le danger de devenir esclave des mouvements
collectifs s’en trouve amoindri d’autant. Tel était le message délivré à Jung
par cette communauté et l’on comprend qu’il l’a aidé à se garder de certaines
puissances non canalisées présentes en son inconscient.
Guerre sainte et laïcité.
On
commettrait pourtant une erreur si l’on assimilait le phénomène de guerre
sainte au seul fait religieux. Les valeurs ne peuvent concerner que la vie su
siècle, subsiste la ferveur collective.
En
effet, la haine qu’encourt un principe vu comme excessif peut générer un excès
tout aussi grand, et lutter contre un ennemi bien défini est toujours rester
sous l’influence de l’idée qu’il représente. Durant la Révolution française,
les soldats de la République qui avaient pour mission de lutter « contre
l’intolérance et le fanatisme » encouraient tout aussi bien le même
reproche. Ainsi le siècle dit des Lumières, dans un souci de progrès resté
décalé par rapport à la réalité psychologique humaine, a tenté de promouvoir
des valeurs devenues autant d’abstractions exerçant leur pouvoir de séduction
sur des âmes prêtes à abdiquer leur liberté en vue de leur réalisation sans
concession. La Justice, la Liberté, le Progrès, la Fraternité, la Tolérance
étaient autant de divinités nouvelles vers lesquelles des hommes tournaient
leurs aspirations et la majuscule qui leur était accolée n’était là que pour
exprimer l’adoration sans bornes que les hommes avaient à leur vouer. Une
divinité était remplacer par une autre, le même zèle religieux justifiait les
violences.
La
Révolution française ne fut pourtant pas le dernier évènement suscitant ces
actions et le XXe siècle ne fut pas en reste dans la volonté des hommes de
déifier leurs actes les plus condamnables pour mieux s’aveugler sur leur
véritable nature. Les régimes totalitaires qui apparurent alors connurent la
même fascination envers cette volonté d’engager une lutte au nom d’un Bien jugé
supérieur, contre un ennemi perçu sous les plus noirs aspects. Ainsi
l’affirmait Jung : « L’absolutisme de la « civitas Dei », de la cité de
Dieu, incarnée par les hommes, ne ressemble malheureusement que trop à la
« divinisation » de l’Etat que prônent les tenants de l’autre bord,
et les conséquences morales qu’un Ignace de Loyola tire de l’autorité de
l’Eglise – à savoir que le but sanctifie les moyens – n’anticipent que trop
dangereusement sur l’usage du mensonge comme instrument de haute politique.
D’un côté comme de l’autre, une soumission totale à la Foi est exigée.
L’individu se trouve ainsi amputé de sa liberté, de sa liberté devant Dieu par
les uns, de sa liberté devant l’Etat par les autres, ce qui dans un cas comme
dans l’autre creuse sa tombe »[4].
Une
image particulière propre à faire le lien entre cette voie suivie par les
hommes du Moyen Age et ce trait de certains régimes dictatoriaux de notre
temps, est celle qui a trait au millénarisme. Le nombre 1000, par l’idée de
profusion qu’il suggère, est tout à fait propre à prendre un caractère
d’éternité, à évoquer une situation intemporelle destinée à durer toujours. Ce
fut ce rêve auxquels cédèrent certains esprits d’autrefois, recherchant la
venue d’un nouvel Age d’or quitte à ce que soit ébranlé l’ordre social. Ce même
désir sous-tendit les révolutions françaises et russes. Il caractérisa le
messianisme de 1848 tout comme la révolution bolchevique de 1917. Surtout un
tel désir va de pair avec une volonté de diaboliser un ennemi extérieur contre
lequel rien n’est jugé trop excessif pour que soit assurée sa destruction.
Ainsi le régime nazi entreprit-il la croisade contre le communisme et contre le
judaïsme et la volonté d’Adolphe Hitler de faire inscrire « Dieu avec
nous » (Gott mit uns) sur les
ceinturons de ses S.A. montre bien le sens pris par sa détermination. De même,
le capitalisme honni fut-il présenté par les communistes comme une véritable
bête de l’Apocalypse. Tel est le caractère pris par la guerre menée alors au
nom de l’idéologie d’un régime.
Que
ce soit sous l’empire d’un dogme religieux ou de celui d’une idéologie
conditionnant la vie d’un Etat, le même symbole mobilise les énergies. Jung
parle de la « ressemblance avec Dieu ». Pour lui, il s’agit de
l’influence exercée par un archétype très puissant présent en notre inconscient
collectif, l’archétype du divin, et qui, parce qu’il est resté ignoré et non
canalisé pour le plus grand bienfait de l’individu, possède l’être humain tout
entier. Il s’ensuit chez ce dernier une certaine frénésie de puissance qui le
voit soumis à des mots d’ordre, abstractions coupées de toute réalité humaine
et concrète. Par un accès de présomption, il connaît « une exaltation
inconsciente et une mise en évidence du Moi, qui peut alors atteindre à une
volonté morbide de domination »[5]
En
définitive, on réalise que le seul dieu auquel les esprits se sont laissés
subjuguer est Moloch, cette divinité des anciens temps à qui les hommes
allaient jusqu’à sacrifier leurs semblables. Aujourd’hui, Moloch a disparu de notre
univers. Ce culte barbare n’en continue pas moins à exerces son emprise sur les
esprits puisqu’il renaît sous la formes d’idées auxquelles ils sacrifient tout
sans concessions. Chronos dévorant ses enfants, le minotaure se repaissant de
ses victimes, sont autant d’images de ce maître avide et insatiable, et si les
hommes ne lui sacrifient plus leurs enfants, ils lui sacrifient leur âme,
immolée alors pour le triomphe d’idées qui, par l’indépendance qu’elles
acquièrent envers leur conscience, font peser leur poids sur la libre
expression de leur personnalité.
Intériorisation de la guerre
sainte.
Pour
Carl Gustav Jung, l’espoir d’épargner de tels maux à l’humanité réside, non
dans la masse, mais dans l’individu. Le psychologue estime en effet que d’une vie réellement
religieuse ne peut que découler « un sentiment fier qui élève l'individu
humain à la dignité d'un facteur métaphysique »[6].
Effectivement,
entre un sentiment religieux exprimé avec autant d’ardeur que par la guerre
sainte et une vie authentiquement religieuse de l’individu assumée en son
intimité avec lui-même, n’existe qu’un rapport fort ténu. C’est le sens pris
par la mystique, l’attirance éprouvée envers le mystère de Dieu présent en
chacun d’entre nous. Toutes les religions ont leur mystique, la relation
individuelle entre Dieu et la créature. Pour
cette raison ceux qui ont suivi cette voie ont toujours suscité la méfiance des
autorités religieuses officielles en raison de l’indépendance d’esprit manifestée
envers la société.
A
cet effet, l’exemple le plus imagé que l’on puisse donner de cet engagement est
celui présenté par l’Ancien Testament et par le lien évident qu’il entretient
avec la guerre. Les Saintes Ecritures évoquent en effet l’Histoire du peuple
hébreu dans son rapport avec Dieu. Tantôt, il connaît des succès, tantôt il
éprouve des revers. Mais les uns et les autres alternent conformément à la
volonté du Tout puissant et sont autant de jalons le faisant progresser sur le
chemin de sa destinée. Ainsi peut-on
parler véritablement d’une mystique de l’Ancien Testament, dans la mesure où
toutes les aventures connues par ce peuple, positives ou négatives, le font à
chaque fois avancer un peu plus dans la connaissance de Dieu. Tel est
précisément le périple dans lequel est engagé l’individu à l’intérieur de
lui-même.
Aussi,
ne faut-il voir les combats menés par Israël, non de manière littérale, mais
uniquement sur un plan métaphorique, chaque lutte n’étant que la projection des
tendances diverses sollicitant l’âme de chacun. Tous les remous agitant notre existence,
images de nos déchirements intérieurs, nous font à chaque fois évoluer un peu
plus dans notre appréhension de nous-mêmes, nous rendant plus sensibles la
volonté du Tout puissant. Tel est le labyrinthe tortueux, image de notre
inconscient et, au-delà, de notre vie même, dans lequel nous cheminons tout en
nous transformant graduellement. Quel que soit le tour pris par les évènements,
les textes chrétiens n’ont jamais présenté la guerre autrement que sous forme
d’images destinées à faire mieux entrevoir au fidèle son combat intérieur.
C’est le sens pris par la lutte menée entre la Lumière et les ténèbres évoquée par
Saint Paul. Ainsi dit-il dans l’une de ses Epitres : « Je te
délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t’envoie, moi,
pour leur ouvrir les yeux, afin qu’elles reviennent des ténèbres à la lumière
et de l’emprise de Satan à Dieu »[7]
Ce
devoir qui nous est imparti nous est rendu plus sensible si l’on observe que
les deux premières religions monothéistes vouent un culte à un dieu vaincu. « C’est lorsque nous
sommes en proie à un affect que nous prenons conscience de nous-mêmes avec le
plus d’acuité, que nous nous percevons nous-mêmes avec le plus d’intensité
[...] un choc au visage, par exemple pourrait être à l’origine des premières
réflexions de l’individu sur lui-même »[8].
Ceci
est vrai dans le cas du Christianisme au sein duquel les croyants ont tourné leurs
aspirations vers un dieu mort sur la croix pour mieux souligner l’idée d’amour
et de charité. Cela ne l’est pas moins dans le cas du judaïsme. Généralement, les
peuples païens abandonnaient toujours le dieu qui ne leur avait pas donné la
victoire. Différent fut le choix des hébreux, connaissant l’épreuve de la
captivité de Babylone. Malgré la détresse dans laquelle semblait les avoir
confinés Yahvé, ils continuèrent à Lui accorder leur foi en élaborant toute la
trame de leur religion. Telles furent les conditions dans lesquelles naquit le
judaïsme au Ve siècle avant JC.
Des
situations comme celle-ci sont en effet bien propres à créer en chacun d’entre
nous une nouvelle conscience, et c’est dans la douleur ressentie que les
richesses insoupçonnées de notre âme se présentent à celle-ci et
l’enrichissent. « C’est
de la souffrance de l’âme que germe toute création spirituelle et c’est en elle
que prend naissance tout progrès de l’homme en tant qu’esprit ; or, le
motif de cette souffrance est la stagnation spirituelle, la stérilité de
l’âme »[9].
En ce sens va le récit de Saint-Exupéry, Pilote
de guerre, l’Histoire de son expérience d’aviateur lors de la défaite de
1940. Quel que soit son caractère dramatique, elle n’en est pas moins destinée à
produire en lui les fruits les plus spirituels. « Je ne m’inquiète pas du
limon épars s’il abrite une graine. La graine le drainera pour construire »[10],
disait-il. Il n’est que d’imaginer pour s’en convaincre l’Iliade écrite par un Troyen ou la deuxième guerre punique narrée
par un Carthaginois.
Légitimée
ainsi, la guerre ne fait que mettre en lumière nos plus noirs instincts. La
mettre sur un piédestal en affirmant la mener au nom d’un principe majeur ne
vise qu’à camoufler ce qu’elle a toujours demeuré, soit le plus terrible des fléaux
humains. Jung estimait que le progrès général découlera, non de transformations
politiques, économiques ou institutionnelles, simplement d’une reconstruction
personnelle de l’individu. A l’éducation et à la culture reviennent le rôle de
transmettre les valeurs nécessaires à sa réalisation. Les grands esprits,
Socrate, Jésus, le Bouddha, se sont toujours adressés aux individus, non aux
masses, ainsi s’est propagé leur enseignement. Saint Augustin le disait:
« Une âme qui s’élève élève le monde ».
Bibliographie :
·
W. Mc Guire et R.F.C. Hull,
C.G.Jung parle. Paris:
Buchet/Chastel, 1985.
·
Carl Gustav Jung, L’homme à la découverte de son âme. Paris : Albin
Michel, 1987.
·
Miguel Rojo Sierra, Introduction à la lecture de Jung. Genève : Georg édition,
1988.
·
Didier Lafargue, La personnalité humaine dans l’œuvre de Carl Gustav Jung.
Montélimar : Edition Castelli, 2013.
·
Didier Lafargue, Saint-Exupéry et la guerre. Revue Choisir, mars 2011, n°615.
(http://www.choisir.ch/religions/spiritualites/item/1380-Résistance)
[1] W. Mc Guire
et R.F.C. Hull, C.G.Jung parle. Paris
: Buchet/Chastel, 1985, p. 24.
[2] Carl
Gustav Jung, L’âme et la vie. Paris :
Buchet/Chastel, 1965. 2e édition, 1969, p.254.
[3] Carl Gustav Jung, Ma vie. Paris : Gallimard,
1973, p.286.
[4] Carl
Gustav Jung, Présent et avenir. Paris
: Buchet/Chastel, 1962, p. 65.
[5] Carl
Gustav Jung, Dialectique du Moi et de
l’inconscient. Paris :
Gallimard, 1964. 2e édition, 1967, p. 65.
[6] Carl Gustav Jung, Ma vie. Paris : Gallimard,
1966. 2e édition, 1967, p. 291.
[7] Saint
Paul, Actes 26, 17-18.
[8] Carl
Gustav Jung, L’homme à la découverte de
son âme. Paris : Albin Michel, 1987, p. 105.
[9] Carl
Gustav Jung, L’âme et la vie.
Paris : Buchet/Chastel, 1965. 2e édition, 1969, p. 330.
[10] Antoine
de Saint-Exupéry, Pilote de guerre.
Paris : Gallimard, 1942, Chapitre XXIV, p.185.